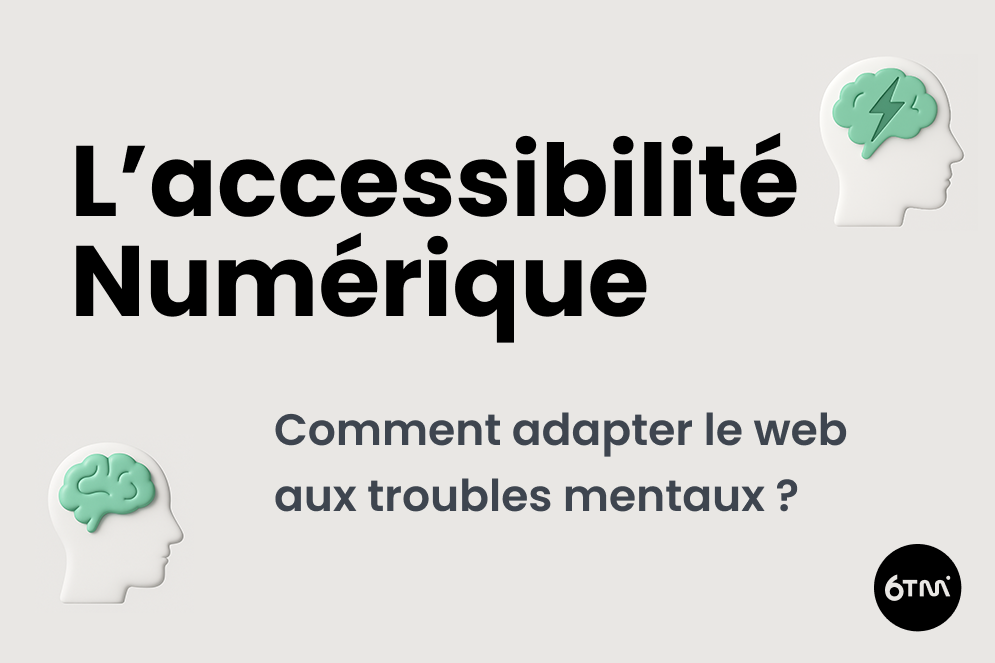Introduction
Comment rendre un site accessible à des personnes dont les difficultés ne se voient pas ? Que signifie concevoir une interface qui respecte les besoins des personnes atteintes de troubles cognitifs, intellectuels ou psychiques ? L’accessibilité numérique est aujourd’hui un enjeu incontournable pour les organisations, mais elle reste souvent abordée sous l’angle des handicaps sensoriels, laissant dans l’ombre d’autres formes de handicap, plus complexes à identifier.
Et pourtant, les troubles mentaux peuvent fortement limiter l’usage d’un site ou d’une application : surcharge d’informations, vocabulaire trop complexe, navigation confuse, absence d’aides visuelles ou d’indications claires… Autant d’obstacles qui fragilisent l’usabilité web, et creusent les inégalités d’accès à l’information, menant parfois à une exclusion numérique.
Dans ce troisième article de notre série consacrée à l’accessibilité numérique, nous nous intéressons aux handicaps mentaux. En nous appuyant sur les recommandations du RGAA et les référentiels internationaux comme les WCAG, nous proposons des pistes concrètes pour concevoir des interfaces plus inclusives et plus justes, dans une logique d’inclusion numérique et d’inclusion sociale.
Ces recommandations ne sont pas exhaustives. L’accessibilité est une démarche d’accessibilité continue, qui repose sur une meilleure connaissance des usages, des tests d’accessibilité, des retours utilisateurs, et des évaluations de conformité régulières. Chez 6TM, nous faisons de cet enjeu une priorité, en accompagnant nos clients et en progressant nous-mêmes, vers un numérique plus responsable, humain, et conforme à la légalité de l’accessibilité.
Comprendre les handicaps mentaux et leurs impacts
Ce que recouvre la notion de handicap mental
L’accessibilité web ne concerne pas uniquement les troubles sensoriels (voir notre article sur ce sujet) ou moteurs : elle englobe aussi les handicaps dits “mentaux”, qui regroupent plusieurs réalités souvent méconnues. Selon la classification d’Access42, on distingue trois types principaux : les handicaps intellectuels, les troubles cognitifs (comme les troubles DYS), et les handicaps psychiques.
Les handicaps intellectuels touchent les capacités de raisonnement, d’analyse ou d’apprentissage. Les personnes concernées peuvent avoir besoin d’un accompagnement plus important pour comprendre et traiter les informations.
Les troubles cognitifs, comme la dyslexie, la dyspraxie ou les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), affectent la manière dont une personne lit, se concentre, retient ou interagit avec une interface. Ces difficultés cognitives doivent être prises en compte dès la conception à l’accessibilité, pour éviter que l’expérience utilisateur ne devienne une source de stress ou d’incompréhension.
Ces handicaps sont qualifiés d’invisibles car ils ne sont pas immédiatement perceptibles, ce qui complique leur prise en compte dans la conception accessible. Pourtant, ignorer ces besoins revient à exclure une partie significative des utilisateurs. L’ergonomie numérique doit donc intégrer ces profils pour réduire les risques d’exclusion numérique.
Les obstacles numériques rencontrés
L’évaluation de l’accessibilité d’un site révèle souvent des obstacles liés à une surcharge cognitive : contenu dense, hiérarchisation confuse, manque de repères visuels. Ces faiblesses nuisent à l’accessibilité mobile, également, car les contraintes d’espace accentuent les erreurs de conception.
Des interfaces surchargées, avec un contenu trop dense ou mal hiérarchisé, rendent la navigation difficile et fatigante. L’absence de repères visuels clairs (titres, icônes, fil d’Ariane) désoriente l’utilisateur et l’empêche de se repérer dans le site.
Des formulaires non balisés, des animations intrusives, un contraste de couleurs insuffisant ou l’absence de synthèse vocale sont autant de freins qui doivent être identifiés lors d’une évaluation de conformité selon les critères de contrôle du RGAA ou des WCAG.
Enfin, des délais d’action trop courts, une surcharge d’informations visuelles ou un manque de cohérence d’une page à l’autre complexifient l’expérience. Tous ces facteurs nuisent à l’accessibilité, et peuvent empêcher certains utilisateurs d’accéder aux services ou à l’information numérique de manière autonome.
Ces constats sont largement documentés dans les référentiels officiels, et alimentent les progrès de l’accessibilité numérique. Ils rappellent combien une méthode technique RGAA, rigoureuse et contextualisée, est essentielle pour proposer des expériences cohérentes, compréhensibles et durables.
Bonnes pratiques pour les troubles cognitifs et intellectuels
Voici une sélection de bonnes pratiques essentielles à mettre en œuvre pour rendre un site web plus accessible aux personnes atteintes de troubles cognitifs, intellectuels ou psychiques. Ces recommandations sont issues du RGAA et des WCAG.
Les bonnes pratiques ci-dessous s’appuient principalement sur deux référentiels reconnus : le RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité), en vigueur en France, et les WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), standards internationaux du W3C. Ces documents fournissent un cadre technique et fonctionnel pour rendre les contenus numériques plus accessibles aux personnes en situation de handicap, en particulier celles atteintes de troubles mentaux, cognitifs ou intellectuels.
Rendre les contenus plus lisibles et compréhensibles
- Utiliser un langage clair et simple : éviter les formulations complexes, le jargon ou les tournures ambiguës.
- Structurer logiquement les pages : organiser le contenu avec des titres explicites, des listes à puces et des paragraphes courts.
- Employer des balises sémantiques :
<h1>,<nav>,<main>pour guider les technologies d’assistance. - Définir les acronymes et abréviations : fournir une explication au premier usage.
Ces actions facilitent non seulement la lecture, mais aussi l’interprétation par les outils de synthèse vocale, notamment pour les utilisateurs présentant des difficultés cognitives.
Définir les acronymes et éviter le jargon permet une meilleure compréhension pour tous, et participe directement à la sensibilité à l’accessibilité dans les équipes de conception.
Ces pratiques, simples à mettre en œuvre dès la conception d’un site, participent à un numérique plus inclusif, bénéfique à tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation cognitive.
L’usage d’un langage clair et simple permet d’éviter les formulations complexes ou les expressions techniques qui peuvent décourager ou perdre les utilisateurs. Ce principe vise à rendre les contenus facilement compréhensibles, sans effort cognitif excessif.
Dans la même logique, il est recommandé de structurer les pages de manière logique et hiérarchisée, en utilisant des titres explicites et des balises sémantiques (comme <h1>, <nav>, ou <main>). Cela facilite la lecture visuelle, mais aussi la navigation via lecteurs d’écran, notamment pour les personnes ayant des troubles de l’attention ou de la mémoire.
Il est également essentiel de définir ou expliciter les acronymes, abréviations ou notions complexes dès leur première utilisation. Cela permet à chacun de suivre une information sans supposer un niveau de culture technique ou professionnelle élevé.
Ces pratiques, simples à mettre en œuvre dès la conception d’un site, participent à un numérique plus inclusif, bénéfique à tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation cognitive.
Faciliter la navigation et réduire la charge cognitive
Une navigation prévisible et cohérente est un principe fondamental de l’accessibilité web. Elle permet de réduire la charge mentale des utilisateurs. Il est recommandé de proposer une navigation linéaire, avec des menus situés au même endroit sur chaque page. Cela permet aux personnes ayant des troubles cognitifs ou de l’attention de se repérer facilement et de limiter les efforts de mémorisation.
Il est également conseillé d’éviter les doubles colonnes, les parcours complexes ou les contenus qui se déplacent dans des zones inattendues. Une organisation simple et logique des informations aide à maintenir l’attention et à éviter la confusion.
Enfin, les pictogrammes et icônes explicites peuvent renforcer la compréhension, à condition qu’ils soient compréhensibles et accompagnés d’un texte ou d’un label accessible. Cette redondance visuelle et textuelle permet de répondre à une diversité de styles cognitifs et de favoriser la clarté de l’interface. L’utilisation de pictogrammes explicites, combinés à du texte, renforce la compréhension grâce à la conception à l’accessibilité.
Aider à la compréhension des formulaires et interactions
Les formulaires peuvent constituer un point de friction important pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Il est crucial d’y apporter une attention particulière pour garantir leur accessibilité.
Chaque champ doit être accompagné d’une étiquette claire et visible, placée à proximité immédiate du champ concerné. Cela évite toute ambiguïté et facilite la compréhension, même en cas de déficience de mémoire ou de concentration.
Les instructions doivent rester visibles en permanence, plutôt que d’être intégrées uniquement dans des placeholders qui disparaissent dès que l’utilisateur commence à saisir du texte. Cette approche réduit les erreurs et rassure les utilisateurs pendant la saisie.
Enfin, les messages d’erreur doivent être explicites, formulés en langage clair, et idéalement accompagnés de suggestions pour corriger l’erreur. Cela permet de rassurer l’utilisateur, de l’aider à comprendre ce qui ne fonctionne pas et à corriger sa saisie de façon autonome.
Ces ajustements doivent être testés via des tests d’accessibilité, pour garantir leur pertinence.
Prendre en compte les troubles psychiques
Éviter la surcharge sensorielle et cognitive
Les personnes souffrant de troubles psychiques peuvent être particulièrement sensibles à la surstimulation visuelle ou sonore. Pour favoriser leur concentration et leur confort, il est conseillé d’éviter les contenus diffusés automatiquement (autoplay) ou à rythme rapide, comme les carrousels animés ou les vidéos non déclenchées manuellement.
Il est également important de proposer des animations que l’utilisateur peut interrompre ou mettre en pause. Cela permet de conserver le contrôle sur l’environnement numérique, réduisant le stress et la perte de repères.
Enfin, un design visuel apaisant, avec des couleurs douces, des contrastes modérés et une interface épurée, participe à créer une atmosphère plus sereine, réduisant les risques de surcharge cognitive ou émotionnelle.
Maintenir un environnement stable et rassurant
Créer un cadre numérique rassurant est fondamental pour les personnes sujettes à l’anxiété ou à la perte de repères, notamment dans le cadre de troubles psychiques. Un feedback cohérent et bienveillant, notamment en cas d’erreur (ex. : messages explicites et non culpabilisants), contribue à sécuriser l’expérience utilisateur.
Il est également préférable d’éviter les changements de page ou de contexte sans avertissement, afin de ne pas désorienter l’utilisateur. Des transitions douces et signalées permettent de garder le contrôle sur la navigation.
Enfin, pour les actions limitées dans le temps (ex. : formulaires, réservations), il est important d’afficher clairement les délais ou les compteurs. Cela évite la précipitation et favorise une interaction plus sereine.
Des transitions douces, une interface stable, une signalétique constante : cette cohérence est rassurante et diminue l’anxiété. Elle est à intégrer dès les premiers ateliers de conception à l’accessibilité, en phase avec les critères de contrôle du RGAA.
Vers une accessibilité continue et globale
Une série qui se termine, un engagement qui continue
Cette série d’articles sur l’accessibilité numérique a permis d’aborder les besoins spécifiques liés aux troubles visuels, auditifs et mentaux. Si ces thématiques sont parmi les plus courantes, elles ne couvrent pas l’ensemble des situations de handicap. D’autres thématiques (motrices, chroniques, polyhandicaps) restent à aborder dans une logique d’accessibilité au travail et d’inclusion numérique globale. Les handicaps moteurs, polyhandicaps ou certaines maladies invalidantes comme les douleurs chroniques, par exemple, nécessitent eux aussi des adaptations spécifiques.
L’accessibilité ne se limite pas à une déclaration d’accessibilité. C’est un engagement de fond, basé sur des retours utilisateurs, des audits, une évaluation de l’accessibilité continue. C’est aussi un champ d’innovation : l’accessibilité est un catalyseur de progrès de l’accessibilité et de qualité.
Notre objectif n’était pas d’être exhaustif, mais de proposer des repères concrets et actionnables pour aider les équipes web à progresser. L’accessibilité n’est jamais acquise : c’est une démarche continue, qui s’affine à mesure des retours utilisateurs et des évolutions techniques. Et chez 6TM, nous croyons que chaque amélioration compte pour rendre le numérique plus équitable.
Se faire accompagner pour aller plus loin
L’accessibilité numérique ne se résume pas à cocher des cases réglementaires. Pour en faire un véritable levier de transformation, il est essentiel d’intégrer cette démarche dès la conception d’un projet digital. Chez 6TM, nous aidons les organisations à intégrer une démarche d’accessibilité dans leurs projets, dès la conception. Grâce à notre expertise en accessibilité web, A11Y, accessibilité mobile, et ergonomie numérique, nous apportons des solutions concrètes, respectueuses de la norme européenne en vigueur.
Nous accompagnons les entreprises et les institutions dans la conception et le développement de sites web sur mesure. Grâce à notre expertise technique et notre approche centrée utilisateur, nous concevons des interfaces robustes, bien structurées, évolutives et adaptées aux besoins de chaque organisation.
Notre objectif : proposer des expériences numériques durables, qui respectent les normes d’accessibilité tout en répondant aux besoins spécifiques de chaque organisation. Pour découvrir comment intégrer ces bonnes pratiques dans vos projets, retrouvez nos services sur 6tm.com.
Conclusion
Rendre un site accessible aux personnes atteintes de handicaps mentaux, c’est répondre aux enjeux d’inclusion numérique, de confort et de clarté pour tous.
Chez 6TM, nous pensons que l’accessibilité ne se limite pas à la légalité de l’accessibilité, mais qu’elle constitue un levier d’innovation inclusive.
Si vous souhaitez progresser dans votre démarche d’accessibilité, améliorer vos services existants ou concevoir dès le départ des expériences accessibles, notre équipe vous accompagne à chaque étape.